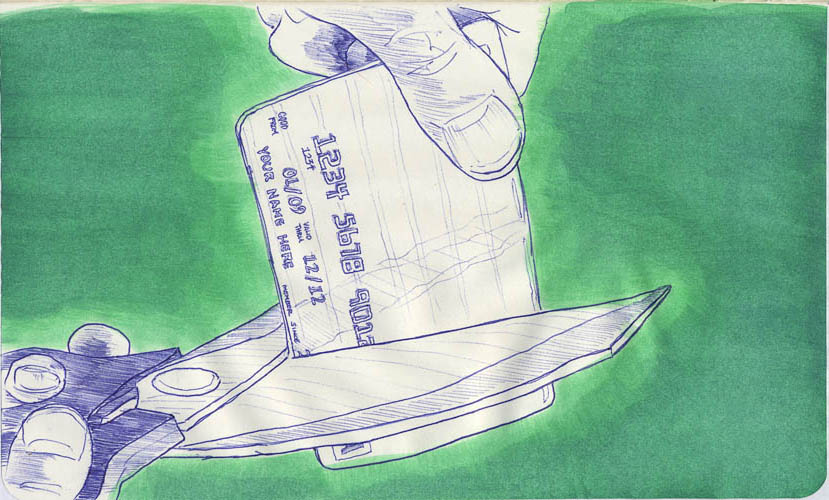Crédit photo : Virginie Chaloux
Il y a un an aujourd’hui, j’apprenais ta présence. J’allais à ta rencontre les yeux fermés, ne sachant pas si j’allais foncer dans le mur qui se trouvait devant moi, aveuglée par tout ce que cette nouvelle pouvait produire de beau et de moins beau. J’étais là, dans mon incertitude, mes contradictions, mon énervement, mes « je sais pas » répétés en boucle à voix basse et à voix moins basse.
J’étais là, assise et seule, mais tellement remplie en même temps; pleine de toi qui grandissais déjà en moi. Mes mains passaient de mon cœur à mon ventre avec l’assurance de celles qui connaissaient déjà le chemin. J’aimerais dire que j’ai su à ce moment que je serais mère, mais je n’ai pas su; j’ai simplement su que tu étais là.
Durant ce temps, certaines de mes amies se mariaient, d’autres tentaient désespérément d’avoir un enfant. Moi, je n’avais rien de tout ça et j’étais bien ainsi. La vérité, c’est que ça n’a pas été clair. C’est que j’ai ouvert Google pour trouver une clinique. C’est que j’ai composé des numéros de téléphone pour fixer un rendez-vous que je n’ai jamais été capable de prendre. C’est que je faisais des cauchemars la nuit.
J’ai longtemps repoussé l’idée de mère, le concept de mère, la structure de mère et tout ce qui charpente cette maison. J’avais peur que ça prenne trop de place, que ça prenne toute la place. Comment être une maison pour quelqu’un alors qu’on ne s’habite pas soi-même?
Puis est arrivé le matin où j’ai su. Où j’ai su que tu allais vivre. Oui, toi, tu vivrais comme le point que l’on met à la fin d’une phrase : comme une évidence. J’étais soudainement prête à tout, mais surtout à toi.
Le jour de mon anniversaire, j’ai appris que je t’appellerais « Mon fils ». Un peu plus tard, nous avons décidé que tu t’appellerais Auguste. « Mon fils », ces deux mots faisant tellement sens lorsqu’on les comprend, lorsqu’on les vit. J’ai alors compris ce qui m’attendait, je serais ta mère, ta maman. Je le savais, évidemment, mais il y a une différence entre savoir quelque chose et comprendre quelque chose.
Ton père et moi avions peur pour notre liberté. Pour nos soirées passées à en « profiter » un peu trop. Pour les journées où on se levait à midi. Pour le temps où on ne pouvait penser qu’à nous. C’est vrai qu’on se réveille à 8:00 maintenant. Mais ça nous permet d’aller courir. De jouer avec toi. D’aller déjeuner en famille et d’avoir le temps d’étudier, d’aller marcher, de lire et d’écrire. Aujourd’hui, je me réveille au son de ton rire dans le soleil du matin au lieu de me réveiller le coeur au bord des lèvres.
Lorsque je regarde les gens de mon âge, il m’arrive de me questionner. Nous sommes dans la jeune vingtaine. Ne devrait-on pas plutôt sortir, voyager, rencontrer de nouvelles personnes, s’y lier, puis rompre, rencontrer à nouveau, ne pas avoir de responsabilités? Je me suis souvent fait avoir par les visages effrayés qui nous disaient « Hein? Un enfant? Déjà? Vous n’êtes pas un peu jeunes? Vous n’avez pas peur de le regretter? »
La vérité est qu’on ne regrette rien. Je nous regarde. Les trois. Nous sommes un clan. On se tient. Toujours. On se sert dans nos bras, on s’aime.
Aujourd’hui, tu es là. Je te regarde grandir comme un horizon infini de couleurs se levant et se couchant sur chaque jour de ma vie. Comme dirait le renard dans le Petit Prince, nous sommes devenus responsables de toi pour toujours en t’apprivoisant. Tu es mon amour guérilla, mon amour comète, celui qui a tué l’angoisse qui se tapissait au fond des tranchées.
Tu es là, comme ce qui va de soi. Tu es le quotidien autour duquel on s’organise; l’endroit où l’on trouve tout l’amour du monde.
Tu es là, avec ta vérité foudroyante et brusque. Avec ton rire doux comme une tornade d’oasis en plein désert. Avec tes mains qui voyagent plus loin que toi. Tu es là, avec ton corps qui grandit plus rapidement que ton âge, avec ta voix qui embrasse tous les murs de notre appartement. Tu es là, comme si tu n’avais jamais été ailleurs.
Oui, tu es là. Et je t’aime.